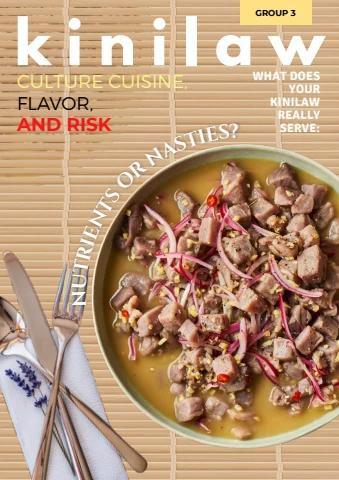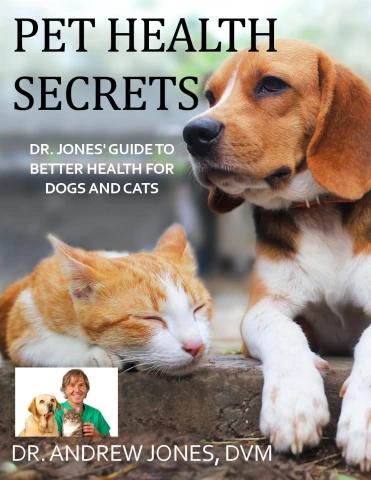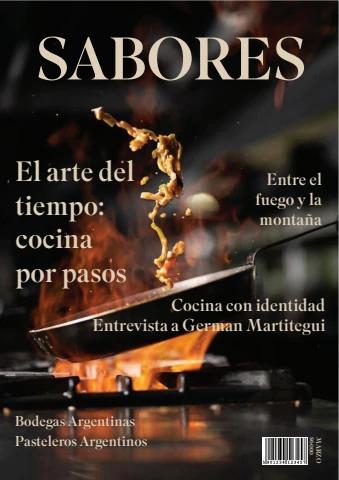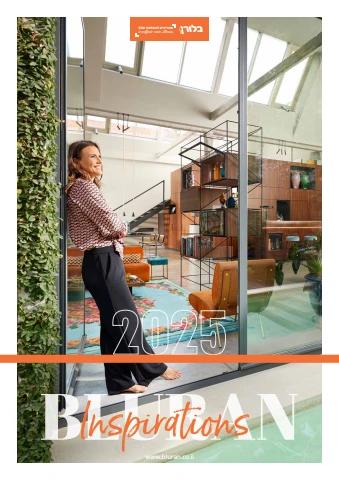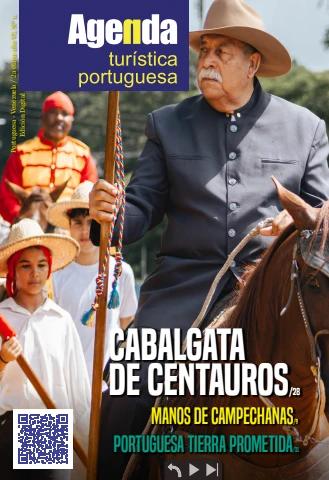Les valeurs de la République Cahiers français n° 336
Les principes républicains : signification et portée
66
Les principes républicains : signification et portée
La laïcité
Si la manière dont s’est imposée la laïcité
en Europe a différé selon les pays et si les
relations entre le religieux et le politique
conservent la trace de ces histoires
nationales, la France se distingue par
l’intensité qu’y a revêtue cette question et
par l’affirmation de son identité laïque dès
er
l’article 1 de sa Constitution.
Dominique Borne après avoir rappelé pourquoi la laïcité – qui postule une communauté des citoyens organisée hors de toute détermination religieuse – est bien une valeur républicaine, retrace les grandes étapes de sa progression depuis la fin du XVIIIe siècle et insiste sur le problème, longtemps si brûlant, de son rapport à l’École.
L’affirmation, au cours des dernières années, de la religion islamique interroge d’une manière nouvelle les valeurs laïques. Confrontée à la revendication identitaire qu’exprime notamment cette affirmation, la laïcité doit trouver un équilibre entre les deux exigences d’égalité et de liberté.
C. F.
La Constitution de la IVe République définit la République dans son premier article : la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Cette énumération est reprise dans le texte de la Constitution de la Ve République qui ajoute que la France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. La République est donc laïque par définition,
indépendante de toute religion, mais garantit la liberté religieuse des citoyens. Autrement dit, et c’est le texte même de la loi de séparation de 1905, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes (article 1), elle ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte (article 2). Ce balancement entre la stricte séparation d’un côté et la liberté de l’autre se retrouve dans l’organisation de l’enseignement. L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un des devoirs de l’État, dit le préambule de la Constitution de 1946 ; ce préambule est repris dans le texte de 1958, mais le principe de liberté de l’enseignement a également valeur constitutionnelle et, en conséquence de ce principe, depuis la loi Debré de 1959, les établissements privés sous contrat d’association bénéficient de subventions d’État et assurent ainsi des missions de service public. La laïcité est, constitutionnellement, un des principes de la République, en représente-t-elle pour autant une valeur ?
Première question : la laïcité est-elle le résultat d’une simple « sécularisation » de la société, de ce long mouvement qui n’est pas spécifique à la France mais qui a touché l’ensemble de l’Europe ? La laïcité relèverait alors plus de l’État que de la République. Deuxième question : la séparation avec le religieux conduit-elle à une neutralité d’abstention ? La laïcité exprime-t-elle le souci de tenir égale la balance entre les différentes formes de vision de l’homme et du monde, religieuses, a-religieuses, voire athées, cléricales ou anticléricales ? S’il en est ainsi, il est bien difficile d’affirmer que la laïcité est une valeur ; une valeur pourrait-elle être neutre ? Si la laïcité est une valeur républicaine, c’ est qu’ elle est partie d’ un ensemble – faudrait-il dire d’une idéologie ? – qui donne couleur et sens à la République. Est-ce à dire, c’est la troisième question, que la laïcité est une valeur de combat contre le religieux ? Est-elle une éthique qui oppose un système moral cohérent au système moral des Églises ? Pour tenter d’éclairer ces questions nous partirons d’un moment historiquement fort de l’histoire de la laïcité, le début du XXe siècle, et d’une pensée en actes, la pensée de Jean Jaurès. Cette première pierre posée, nous analyserons la laïcité dans son parcours de longue durée, puisqu’elle se construit dans une histoire, avant de tenter d’analyser la laïcité au regard des problèmes de la France et de l’Europe d’aujourd’hui.
La laïcité, une valeur républicaine
Le 30 juillet 1904, Jaurès prononce le discours de distribution des prix de son ancien collège de Castres, le jour même où les relations diplomatiques sont rompues entre la France et le Vatican. Jean Jaurès est élu député pour la première fois en 1885, sa génération est celle des lois laïques de Jules Ferry, il a soutenu les mesures de Combes contre les Congrégations et joue,
aux côtés d’ A ristide Briand, un rôle important dans la préparation de la loi de Séparation des Églises et de l’État. Devant les élèves du collège, Jaurès affirme l’identité entre la démocratie et la laïcité. Et il argumente ainsi :
Si la démocratie fonde en dehors de tout système religieux toutes ses institutions, tout son droit politique et social, famille, patrie, propriété, souveraineté, si elle ne s’ appuie que sur l’ égale dignité des personnes humaines appelées aux mêmes droits et invitées à un respect réciproque, si elle ne se dirige sans aucune intervention dogmatique et surnaturelle, par les seules lumières de la conscience et de la science, si elle n’attend le progrès que du progrès de la conscience et de la science, c’est-à-dire d’une interprétation plus hardie du droit des personnes et d’une plus efficace domination de l’esprit sur la nature, alors j’ai bien le droit de dire qu’elle est foncièrement laïque, laïque dans son essence comme dans ses formes, dans son principe comme dans ses institutions, et dans sa morale comme dans son économie. Ou plutôt, j’ai le droit de répéter que démocratie et laïcité sont identiques.
Le 21 janvier 1910, Jaurès est à la tribune de la Chambre des députés, la séparation est faite depuis 1905, le débat porte sur la querelle des manuels scolaires – source de frictions constantes entre les républicains et les catholiques. C’ est l’ occasion pour lui de définir une nouvelle fois ce qu’est à ses yeux la laïcité. Évoquant les principes de vie des sociétés modernes, il y range la laïcité comme l’ acte de foi dans l’ efficacité morale et sociale de la raison, dans la valeur de la personne humaine raisonnable et éducable.
Avec Jean Jaurès, posons donc la laïcité comme valeur de la République et demandons-nous dans quel système elle prend sens. L’identité démocratie/laïcité place la laïcité dans le champ du politique, de l’organisation globale de la cité. La démocratie se dirige sans aucune intervention dogmatique et surnaturelle, il faut donc qu’ elle se fonde sur l’ exercice de la raison. C’ est affirmer, Jaurès le dit à la Chambre en novembre 1906, lors d’ un débat sur l’ application de la loi de Séparation, que la République n’est pas un dogme, et il poursuit je dirais presque qu’ elle n’ est pas une doctrine ; elle est avant tout une méthode. Il ne s’agit donc pas de remplacer un dogme par un autre. Seule la séparation de l’ ordre politique et de l’ ordre religieux, c’ est-à- dire, répétons-le, le rejet de tout dogme, peut fonder la démocratie, la France a fait une Révolution contre le droit divin qui légitimait une autre forme d’organisation politique. La démocratie elle-même se fonde sur l’égale dignité des personnes humaines appelées aux mêmes droits. La laïcité suppose donc que tous les hommes aient un accès égal à la raison et qu’ ils soient égaux en droits dans l’ usage de cette raison. La laïcité est l’ acte de foi dans l’ efficacité morale et sociale de la raison parce qu’elle suppose la capacité de chaque personne de penser librement sans le secours de vérités extérieures et imposées. Être laïque c’ est raisonner sans a priori, c’ est-à-dire librement ; cette méthode s’apprend : le lien entre la laïcité et la nécessité d’éducation est naturellement affirmé, en dehors de tout dogme l’ école apprend l’ exercice de la
raison et de la pensée libre. L’enseignement doit être soustrait à toute étroitesse sectaire. La personne humaine est à la fois raisonnable et éducable. Ajoutons enfin, pour être complet, que Jaurès appelle à la liberté et à la modernité tous les protagonistes de ce débat, sa pensée n’ est nullement antireligieuse. En 1906, s’adressant aux catholiques, il s’exclame : Pourquoi ne saisissez-vous pas l’occasion incomparable que la loi de séparation vous offrait de vous délier des puissances politiques et sociales du passé, et de rentrer en communication avec les deux grandes forces du monde moderne, la science et la démocratie ?
L’inscription de la laïcité dans l’histoire française
De la distinction de l’Église et de l’État à leur séparation
La laïcité en France s’est construite dans une histoire dont le premier acte commence avec la Révolution de 1789, et même un peu auparavant quand le roi Louis XVI, par l’édit de 1787, réaffirme certes que la Religion Catholique jouira seule, dans notre Royaume, des droits et des honneurs du culte public, mais accorde cependant aux protestants un État civil. Commence alors tout un mouvement qui enlève à l’ Église, pour le confier à l’ État, le contrôle des Français dont dorénavant la vie « civile » ne se confond plus avec la vie religieuse. Avant même que l’ on ne parle de République, c’ est l’ État qui est bénéficiaire de la sécularisation. La première dimension de la laïcité, c’est la fin de la confusion entre la loi religieuse et la loi civile. Le mouvement s’ étend sur plus d’ un siècle, il passe par exemple par la déconfessionnalisation des cimetières, le divorce (1884), le service militaire imposé aux clercs... jusqu’ à la loi Veil de 1975 qui autorise l’ interruption volontaire de grossesse malgré l’opposition de l’ Église. Bien entendu la naissance d’ une école publique, contrôlée par l’État, fait partie de cet ensemble de décisions, nous reviendrons sur cet aspect qui prend par la suite une place centrale dans l’histoire de la laïcité. La Révolution innove dans un autre domaine. La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, proclame – c’ est l’ article 10 – que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. Cet article établit la liberté de pensée, les citoyens ne sont obligés par aucun dogme, ils peuvent pratiquer librement leur religion. Le catholicisme n’est plus religion de l’État.
Ces acquis demeurent, malgré un bref retour en arrière entre 1814 et 1830, mais la Révolution ne parvient pas à établir des rapports stables avec l’Église catholique. La Constitution civile du clergé tente d’établir une Église nationale, le Directoire essaie une première séparation, mais c’est le Premier consul Bonaparte qui reconstruit l’édifice en signant un
Les valeurs
de la République Cahiers français n° 336
Les principes républicains : signification et portée
67
Les valeurs de la République Cahiers français n° 336
Les principes républicains : signification et portée
68
concordat avec le Pape : l’Église retrouve sa place et ses privilèges, prêtres et évêques – le clergé séculier – sont rémunérés, et donc contrôlés, par le pouvoir. En échange, le clergé prêche la soumission aux régimes successifs : on chante d’abord dans les églises le Domine salvos fac consules, il suffit ensuite de s’adapter ; les clercs implorent Domine salvum fac imperatorem, à partir de 1804, ils remplacent imperatorem par regem, pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet, entonnent Domine salvam fac rempublicam en 1848, imperatorem quand le Prince- Président rétablit l’Empire en 1852, et rechantent enfin – mais du bout des lèvres – Domine salvam fac rempublicam à partir de 1870. Parallèlement les autres cultes – les deux protestants, calviniste et luthérien, et le judaïque – étaient régis de manière comparable. La laïcité, de la Révolution de 1789 à la Séparation de 1905, se construit d’abord sur le terrain politique. Les Républicains mesurent la montée en puissance de l’Église tout au long du XIXe siècle ; c’est contre elle, alliée aux monarchistes, qu’ils ont réussi à organiser le régime, c’est contre elle qu’ils se retrouvent dans la coalition de Défense républicaine après la crise de l’ A ffaire Dreyfus. L’ Église, alors, a soutenu la vérité révélée, la vérité dogmatique des institutions établies contre la vérité née de la recherche libre et critique. L’Église de France est donc restée celle du Syllabus (1), qui refuse la liberté et le monde moderne et, à contre-courant du cours impétueux du siècle, rejette la science et le progrès. Se défendre des menées de l’Église, c’est donc défendre la République.
La première offensive frappe les Congrégations – le Concordat ne traitait que du clergé séculier – : l’ extraordinaire croissance des ordres religieux, leur richesse, la puissance et l’ influence qu’ ils ont acquis dans l’enseignement et dans la presse inquiètent les Républicains. Mais, dans un premier temps tout au moins, l’expulsion des Congrégations au début du XXe siècle ne signifiait pas nécessairement pour Émile Combes l’abandon du Concordat ; les congréganistes sont dangereux parce que non contrôlables. Comme le dit Aristide Briand dans la conclusion du rapport qu’il signe au nom de la commission qui examine la loi de séparation : « Depuis l’avènement de la IIIe République, les hommes d’État qui se sont succédé au pouvoir ont persisté dans la poursuite de cette chimère : asservir à leurs desseins la puissance de l’Église. Et la plupart se sont bercés de cette illusion que le Concordat pouvait leur en donner les moyens ».
Dans ce contexte, quand la Séparation devient inévitable, tous les Républicains ne lui donnent pas le même sens. Pour Briand, la loi est une simple mise en conformité : « il n’est plus personne pour contester sérieusement que la neutralité de l’État en matière confessionnelle ne soit l’idéal de toutes les sociétés modernes... Le maintien d’un culte officiel est un défi à la logique et au bon sens... » Les plus modérés, mais aussi Jaurès, voient dans la loi l’ouverture vers la liberté, ils combattent le cléricalisme, toutes les ingérences de l’Église dans le domaine temporel. Les
plus radicaux, au contraire, veulent une séparation offensive, voire antireligieuse, qui ne se limite pas à l’affirmation de la neutralité de l’État. Face à une Église puissante et foncièrement réactionnaire, la République doit afficher des valeurs ; la laïcité qui triomphe en 1905 porte en elle le progrès et la raison. Ainsi les valeurs laïques naissent du conflit mais elles s’impriment dans les mémoires et perdurent quand le conflit est clos et quand l’Église catholique ne constitue plus une menace pour la République.
La laïcité et l’École
Il est vrai que l’ évolution du conflit autour de l’ École relance régulièrement la tension laïque. François Guizot, revenant dans ses Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps sur son œuvre au ministère de l’Instruction publique en 1833, montre parfaitement que l’enjeu fondamental du conflit est ce qu’il appelle le gouvernement des esprits. L’Église en a perdu le monopole, l’intelligence et la science se sont répandues et sécularisées... la science a cessé de vivre sous le même toit que la foi... En devenant plus laïques, l’intelligence et la science ont prétendu à plus de liberté. Ce gouvernement des esprits, l’État ne peut s’en désintéresser. La loi Guizot de 1833 oblige chaque commune à créer une école primaire et installe dans chaque département une École normale destinée à former les maîtres. Cependant la loi laisse d’ une part toute l’ exclusivité de l’ enseignement moral, nécessairement religieux, à l’Église et aux familles, et réaffirme d’autre part la liberté de l’enseignement : l’école peut être privée ou publique. Ces décisions sont fondatrices des deux grands débats autour de l’ École qui se poursuivent depuis plus d’ un siècle et demi. Le premier débat tourne autour de la liberté : si l’ État crée et contrôle l’ école publique, doit-il tolérer le maintien d’un secteur « libre » essentiellement contrôlé par l’Église ? Le second débat tourne autour de la morale : l’école publique doit-elle intégrer une morale restée religieuse ? Autrement dit, la morale peut-elle être « républicaine » ? Le débat sur la liberté a rebondi d’un siècle à l’autre : affirmée pour le primaire par la loi Guizot de 1833, la liberté de l’enseignement est conquise pour le secondaire par la loi Falloux de 1850, et la lutte contre les Congrégations est en partie une lutte contre l’enseignement privé catholique ; la loi Debré de 1959 relance le débat et, en 1984, la gauche au pouvoir doit renoncer, sous la pression de la rue, au « grand service public laïque » que le candidat Mitterrand avait promis d’instituer. Le deuxième débat est, dans son principe, tranché dès Jules Ferry : la loi de 1882 remplace l’éducation morale et religieuse par l’éducation morale et civique. Mais le civisme, valeur laïque, peut-il être inculqué comme l’ était le catéchisme ?
(1) Recueil « contenant les principales erreurs de notre temps » qu'adressa le pape Pie IX aux évêques en décembre 1864.
La question de la laïcité aujourd’hui
Valeurs laïques
et affirmation de l’islam
Comment analyser la laïcité aujourd’hui ? Les valeurs laïques se sont affirmées dans des combats politiques, la République s’est construite contre les conservateurs, soutenus par la grande majorité des catholiques ; aujourd’hui, l’Église n’est plus une puissance politique, les catholiques ne constituent pas un « parti », la laïcité est revendiquée par l’ensemble de l’échiquier politique. Mais la laïcité doit affronter un tout autre contexte. Le pluralisme religieux est dorénavant une réalité que personne ne peut ignorer. Comment faut-il aujourd’hui traiter un islam, qui n’est pas constitué comme une Église, qui ne peut être concerné par la loi de 1905 ? L’islam n’a guère préoccupé l’opinion tant qu’il est resté un islam souterrain, l’islam des caves et des garages. Il a posé problème à la société française et interrogé les valeurs laïques quand il s’est manifesté de manière visible : ce sont, depuis les années 90, les successives affaires autour du « foulard », mais aussi les revendications de construction de mosquées, les problèmes de la formation des imams... Cette visibilité, accompagnée d’une présence accrue au plan international, a été ressentie comme un « retour du religieux » d’autant plus menaçant que l’opinion vivait dans l’idée d’une marche constante vers la sécularisation des sociétés.
À la demande du président de la République, la commission Stasi, commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, devait répondre à ces inquiétudes de l’opinion. Le long et passionné débat autour des recommandations de la Commission, et plus particulièrement de la loi du 15 mars 2004 qui interdit dans les écoles, collèges et lycées publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, témoigne de la profondeur du malaise. La controverse est alors déplacée. La laïcité dénonce dorénavant les communautarismes. Le débat d’autrefois opposait ceux qui chantaient la Marseillaise à ceux qui entonnaient Catholiques et Français toujours. Le religieux apparaît désormais comme le marqueur culturel des communautés, comme un des signes essentiels de l’identité. Le principe laïque veut que chaque Français soit citoyen avant d’être catholique, protestant, juif ou musulman. La loi de mars 2004, qui relève donc de l’égalité, rappelle ce principe de base. Que l’École, qui a été au cœur de tous les débats laïques, soit le lieu choisi pour affirmer à nouveau les principes fondateurs est symbolique. Les politiques n’ont pas osé suivre dans leur totalité les prescriptions de la Commission Stasi sur la laïcité dans l’ensemble des services publics, sur la prise en compte des fêtes d’autres religions que le christianisme, par exemple. Cette dernière mesure aurait pourtant permis de prendre acte du pluralisme religieux. Il est plus facile de résoudre les crises en provoquant le rassemblement autour des principes de l’égalité que de mettre en œuvre une imagination créatrice au service des libertés.
Une tension entre l’égalité et la liberté
Car c’est bien ici, dans ce lieu de tension entre l’égalité et la liberté, que nous retrouvons la laïcité dans sa vie active et féconde. Cette tension est toujours présente parce que la laïcité n’est pas le simple résultat d’un lent mouvement de sécularisation. Cette histoire, en France, est encore chaude. Nous retrouvons la pensée de Jaurès qui nous a permis d’ouvrir cette réflexion. Quand Jaurès explique l’identité entre laïcité et démocratie, c’est l’égalité citoyenne qu’il évoque, mais quand il affirme que la République n’est pas un dogme, c’est à la liberté qu’il fait référence. Ainsi la loi qui interdit dans l’enceinte des établissements publics les signes qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse n’a pas occulté un autre texte qui donne aux élèves la liberté d’expression et donc de croyance. Tension entre l’égalité et la liberté, la laïcité n’est donc pas neutre ; et le débat démocratique sur les principes est par lui-même fécond : ceux qui sont plus sensibles à la dimension égalitaire et citoyenne peuvent dialoguer avec ceux qui mettent d’abord en avant la liberté des personnes et des croyances. Les uns et les autres peuvent être des républicains laïques conséquents. Il est vain d’opposer une laïcité d’arrière-garde à une laïcité « ouverte ». Mais la pensée de Jean Jaurès nous permet de surplomber ce débat, elle offre une voie qui reste neuve lorsqu’il explique que la laïcité est une méthode, et l’acte de foi dans l’efficacité morale et sociale de la raison. La clef, le principe républicain par excellence, c’est l’opposition de la raison au dogme. La raison qui renvoie et à l’égalité citoyenne – être laïque c’est nécessairement penser que tout homme est raisonnable – et à la liberté des personnes, puisque la raison suppose naturellement la totale liberté de la pensée. C’est pour cela que la laïcité, qui ne peut être en aucun cas un principe dogmatique de la République, est avant tout une pratique, c’est pour cela aussi que le lieu d’élection de la laïcité est l’École. La laïcité peut alors être une éthique, mais une éthique de recherche et non d’affirmations closes. Être laïque, c’est préférer la recherche de la vérité, et donc la pratique du doute critique, à la vérité révélée. La laïcité ainsi comprise ne se réduit pas aux signes extérieurs du religieux, elle est méthode, elle est pédagogie. Elle refuse les absolus de la vérité, elle respecte les croyances mais apprend à distinguer le savoir et la croyance. Et si elle cherche à enseigner quelques cheminements vers une morale, c’est à l’apprentissage personnel et opiniâtre de la recherche du vrai qu’elle se consacre.
Dominique Borne, Doyen honoraire de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, Président de l'Institut européen en Sciences des religions
Les valeurs
de la République Cahiers français n° 336
Les principes républicains : signification et portée
69
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
test
- 1 - 4
Pages: